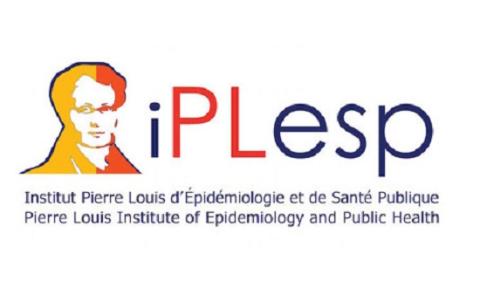
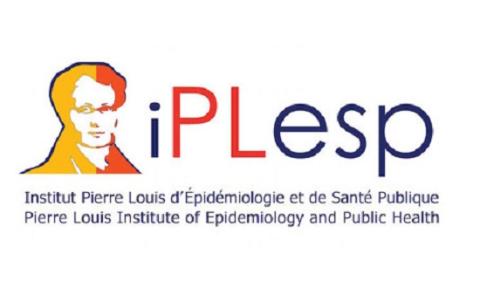
L’IPLESP à la pointe de la recherche sur la COVID-19
Dès le mois de janvier 2020, les équipes de l’Institut Pierre-Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique ont engagé des travaux de recherche sur le SARS-CoV-2 et la COVID-19 dans des domaines très diversifiés : modélisation, surveillance, épidémiologie en population, épidémiologie clinique, virologie, évaluation thérapeutique, épidémiologie sociale.
Deux ans plus tard, il est possible d'en dresser un bref bilan :
- une contribution majeure dans la modélisation de scénarios explicatifs et de contrôle de la pandémie, à destination des autorités de santé pour aider à la décision et la gestion de la crise sanitaire.
- un positionnement national et européen de premier plan sur des thématiques allant de l'évaluation de l'efficacité de stratégies thérapeutiques et préventives de la Covid-19 "en vraie vie", à la prise en charge hospitalière et ambulatoire, le Covid-long, l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale...
- la production de connaissances essentielles en santé publique sur la surveillance en médecine de ville, la séroprévalence et son évolution, les indicateurs de sévérité de l'infection, l'émergence de résistance, l'impact en population et hospitalier de la crise et du confinement.
Tous ces travaux ont pu être conduits grâce à une réorganisation des travaux que menaient ces équipes, l'obtention de financements importants (Investissements d'Avenir, ANR, Européen), la mise en place de nombreuses collaborations nationales et européennes, et surtout, par la volonté des chercheurs de l'IPLESP de contribuer à l'effort national et international de recherche sur cette émergence. Un partenariat privilégié, préexistant à cette crise mais renforcé pendant celle-ci, a été renouvelé avec l'ANRS-MIE. Au 1er avril 2022, ces recherches ont donné lieu à plus de 200 publications dont certaines dans des journaux prestigieux (Nature, Nature Medicine, Science, Lancet, ...). Cinq séminaires thématiques de l'IPLESP sur la Covid-19 ont été mis en ligne sur la chaîne Youtube de la faculté de médecine.
Cette pandémie n'est pas terminée et les recherches continuent. Parmi les travaux en cours, on peut citer la modélisation de la récurrence épidémique et les conditions de son contrôle, l'évaluation du statut sérologique de la population, l'exploration immuno-inflammatoire et clinique des patients atteints de Covid-long, l'évaluation en vraie vie des stratégies médicamenteuses de prévention des complications - notamment immunothérapies, chez les sujets à risque, l'impact médico-économique de la pandémie sur les prises en charge de maladies chroniques, ....
Fabrice Carrat

Interview de Vittoria Colizza
Le laboratoire de l'IPLESP s'est mobilisé pendant la crise du COVID, sur quels projets a travaillé votre équipe?
Nous avons travaillé sur plusieurs projets différents tout au long des différentes phases de la pandémie. Nous avons mobilisé notre laboratoire très tôt, en janvier 2020, pour estimer le risque d'invasion du SARS-CoV-2 depuis la Chine et le mettre à jour sur la base d'informations inédites rapidement disponibles, presque à l'heure près. Nous avons ensuite développé un modèle de transmission structuré par âge, capable d'intégrer des données de mobilité en temps réel (grâce à un partenariat avec les laboratoires d'Orange financé par l'ANR) pour tenir compte des changements de comportement dans le temps dus aux restrictions appliquées. Cette approche nous a permis de fournir une estimation précoce de l'impact du premier confinement, avant les données de surveillance, et elle a ensuite été mise à jour et utilisée tout au long de la pandémie pour : anticiper l'efficacité d'autres restrictions (par exemple, le 2e et 3e confinement, le couvre-feu), évaluer la fatigue pandémique et son impact sur l'adhésion aux mesures de distanciation sociale, anticiper les rebonds épidémiques dus à de nouveaux variants émergents avec une population de plus en plus vaccinée.
Un autre projet important sur lequel nous avons travaillé portait sur la transmission dans les écoles, pour laquelle il y a eu des connaissances limitées pendant longtemps en raison de la fermeture des écoles et de l'absence de tests chez les enfants. Très tôt, en mai 2020, nous avons identifié des protocoles pour rouvrir les écoles en toute sécurité, après le premier confinement. Puis, grâce à des données de contact à haute résolution collectées dans différents milieux scolaires, nous avons pu montrer comment les milieux scolaires favorisent la transmission et -en même temps- mettre en lumière l'efficacité variable de différents protocoles scolaires. Nous avons montré que le dépistage régulier des élèves à l'école permettrait de prévenir largement les cas tout en réduisant les journées d'école perdues. Dans ce cadre, nous avons également évalué l'intérêt de la vaccination des enfants comme moyen de réduire les infections et de préserver la fréquentation scolaire.
Tous ces résultats ont été présentés dans des rapports techniques communiqués aux autorités publiques pour éclairer leurs décisions, et mis à disposition en ligne.
Les modélisations sur lesquelles vous avez travaillé ont aidé le gouvernement à prendre des décisions. Pensez-vous que la population peut maintenant vivre avec ce virus?
Nous travaillons actuellement à l'évaluation des scénarios possibles pour le prochain hiver, ou en cas d'émergence d'un nouveau variant présentant des caractéristiques différentes de celles observées jusqu'à présent. De multiples variables entrent en jeu, et le défi le plus difficile réside dans notre compréhension de l'immunisation. Par exemple, dans le cas d'une population largement vaccinée comme en France, nous devons évaluer dans quelles conditions la diminution de la protection immunitaire au fil du temps peut entraîner une vague importante pour le système hospitalier, et comment structurer une campagne de vaccination pour la prévenir. Nous devons également tenir compte de la reprise de la circulation de la grippe, qui a été supprimée au cours des hivers précédents par l'application de restrictions strictes et de mesures de protection individuelle (par exemple, le masque).
Nous continuons à travailler sur les protocoles scolaires afin de pouvoir définir des seuils optimaux pour déclencher des protocoles adaptés à l'incidence qui augmente, sur la base d'un ensemble d'objectifs - par exemple, minimiser les perturbations scolaires et réduire le risque d'infection - pour se préparer à la prochaine rentrée scolaire.
Sur quels projets l'IPLESP travaille avec l'institut Pasteur, en lien avec le COVID?
Nous avons largement collaboré face aux variants émergents, pour anticiper leur impact sur l'épidémie et sur le système hospitalier, mais aussi sur la vaccination, en combinant une perspective au niveau de la population et une autre centrée sur des milieux spécifiques, comme l'école par exemple. La complémentarité de nos approches nous a permis, d'une part, de valider de manière croisée les résultats des modélisations face à de grandes incertitudes, et d'autre part, d'apporter des perspectives différentes à un même problème de santé publique (par exemple, sur la vaccination des enfants, avec l’évaluation du bénéfice au niveau de la population et pour les enfants eux-mêmes et leur scolarité).
Est-ce que des moyens supplémentaires ont aidé/accéléré la recherche?
Sans aucun doute les financements spécifiques au COVID (provenant d'organismes nationaux et internationaux) nous ont beaucoup aidés. Nous avons décidé d'abandonner tous nos projets en cours en janvier 2020 pour consacrer toutes nos ressources à la réponse à la pandémie. Cela a été possible grâce au dévouement total et sans relâche des membres du laboratoire, qui - malgré leur jeune âge professionnel (principalement des doctorants) et leur manque d'expérience spécifique en matière de réponse aux épidémies - ont travaillé sans relâche pour contribuer à améliorer notre compréhension de la pandémie et notre degré d'anticipation.
De même, la mobilisation de toute une communauté de scientifiques de différents domaines, par le biais d'agences telles que REACTing d'abord et ANRS-MIE ensuite, nous a considérablement aidé à la compréhension des multiples défis posés par l'agent pathogène (des aspects épidémiologiques aux aspects cliniques, virologiques et immunologiques, etc.). Les collaborations au niveau européen ont également fourni une perspective multinationale, nécessaire pour comparer les connaissances et tirer des enseignements des différents contextes épidémiques résultant de différentes trajectoires épidémiques (par exemple, un pays touché en premier par un nouveau variant émergent) et/ou de différentes gestions de la pandémie (par exemple, l'application de restrictions, le rythme de la campagne de vaccination).
Mais la clé de la réponse rapide a également été des collaborations bien établies qui préexistaient à la pandémie de COVID-19. La collaboration à long terme avec Santé publique France en temps de paix, ainsi que lors des précédentes épidémies, a permis une interaction solidement fondée sur une compréhension commune des questions de santé publique, des objectifs et des approches, ainsi qu'une communication informée des résultats et des limites de la modélisation. Tous ces aspects doivent être établis hors crise (en peacetime), afin d'être prêt à travailler ensemble lors d'une crise épidémique et de santé publique.
Pour l'avenir, je pense que le renforcement et la structuration de ces collaborations, en lien avec la communauté scientifique et médicale impliquée dans la lutte contre les pandémies, tout en assurant un financement dédié, sont essentiels afin d'assurer la préparation et la réponse aux menaces épidémiques émergentes.
